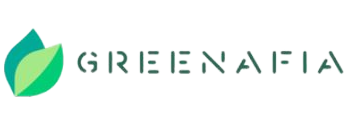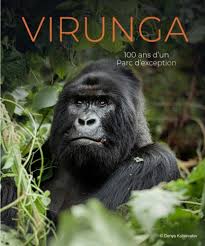Autrefois, la cueillette du fourrage était une tâche traditionnelle confiée aux enfants qui accompagnaient leurs parents aux champs. Les enfants scolarisés étaient également sollicités de se rendre dans les périphéries de la ville après l’école pour en chercher. Aujourd’hui, la situation a évolué : adultes et enfants achètent désormais le fourrage en gros pour le revendre en détail dans les quartiers, une pratique qui soulève des interrogations concernant l’application de la législation sur la protection des enfants. Par ailleurs, la rentabilité de l’élevage de ces petits animaux, désormais nourris à prix d’or, est remise en question. Découvrez les conclusions d’une étude scientifique à la fin de ce blog de Hervé Mukulu.
Lors de son dernier voyage entre les villes de Beni et Butembo, séparées par 54 km dans la partie nord de la province du Nord-Kivu, à l’est de la RDC, le journaliste de la Voix de l’UCG Jackson Sivulyamwenge a été frappé par l’ampleur croissante du phénomène de la vente de fourrage par les enfants le long de cette route nationale, particulièrement dans certaines agglomérations. Ce phénomène soulève de nombreuses préoccupations concernant les risques auxquels ces enfants, âgés de 5 à 10 ans, sont exposés.


Le long de la route nationale numéro 2, au niveau des villages de Mataba et Mukulia, il s’entretient avec deux enfants qui sont à la recherche de clients.
« Je vends du fourrage pour gagner de l’argent, ainsi je pourrais acheter une poule ou un lapin. Un matin, quelqu’un m’a demandé d’aller chercher des fourrages pour lui, et c’est ainsi que j’ai commencé il y a une semaine. En une seule semaine, j’ai gagné 30 000 francs, et un tas de fourrage coûte 500 francs. C’est ma mère qui garde mon argent », raconte Joffrey, un enfant d’environ 8 ans.
« Moi, je vends pour mon ami. Aujourd’hui, je n’ai rien rapporté », ajoute un autre petit, âgé d’environ 5 ans.
À l’origine de cette situation, plusieurs acteurs éducatifs pointent la pauvreté des parents, exacerbée par la guerre dans la région du Nord-Kivu.
Depuis plusieurs années, la Division Genre, Famille et Enfant, avec l’appui de plusieurs partenaires, dont le Parlement des Enfants, lutte contre le travail des enfants à Beni, mais ces efforts demeurent infructueux.
Parmi les acteurs engagés dans cette lutte, le Dr Joël Kavuya, encadrant principal du Parlement des Enfants dans la coordination du Grand Nord, rappelle que l’exploitation économique et sociale des enfants et des adolescents est formellement interdite, conformément à l’article 34 de la loi de janvier 2009 relative à la protection de l’enfance.
« Bien que la loi soit sévère, elle reste la loi. Les gens doivent comprendre qu’un enfant de moins de 16 ans ne peut pas travailler, c’est interdit. Je pense qu’il est grand temps que la police de protection de l’enfance assume ses responsabilités et joue pleinement son rôle, car l’enfant n’a pas la capacité de donner son consentement. Cet enfant qui cherche à collecter des fourrages est d’abord exposé à des accidents. Par exemple, lorsqu’il traverse les routes, les acheteurs peuvent être arrogants, et obliger l’enfant à traverser, ce qui pourrait entraîner un accident. De plus, l’enfant court également le risque d’être enlevé, notamment sur la route Beni-Butembo, où il existe des risques de kidnapping », prévient-il.
Selon lui, bien que la gratuité de l’éducation primaire ait contribué à réduire ce phénomène, l’encadrement efficace demeure insuffisant. En plus de l’implication du gouvernement, Joël Kavuya insiste sur la grande responsabilité des parents, qu’il juge souvent négligents dans la protection de leurs enfants.
Dans la culture des Nandes, on apprend aux enfants à prendre des responsabilités dès leur jeune âge, notamment à travers l’élevage du petit bétail.




Rappelons le contexte de cette région, majoritairement habitée par le peuple Nande, réputé pour son activité commerciale. Cependant, leur première activité, celle qui fonde leur richesse et leur survie, reste l’agriculture. Cette dernière est souvent accompagnée de l’élevage du petit bétail, qui se nourrit des produits secondaires : les mauvaises herbes des champs, les restes de nourriture, ainsi que les déchets végétaux. Les cobayes, lapins, chèvres et porcs se nourrissent ainsi de ces surplus, et la volaille, quant à elle, se nourrit naturellement en liberté. Cet élevage n’est donc aucunement en concurrence alimentaire avec l’homme.
Au fil des années, les agglomérations se sont urbanisées, et les champs se sont éloignés des centres urbains. Avec la scolarisation, les jeunes enfants n’accompagnent plus quotidiennement leurs parents aux champs. Pourtant, c’est aux jeunes qu’incombe la tâche de récolter le fourrage pour le petit bétail, quelques minutes avant l’heure vespérale où il faut quitter le champ. Ainsi, tout le monde joue un rôle utile au sein de la famille.
Avec l’essor de la scolarisation, les enfants partent à l’école le matin et en ressortent en milieu d’après-midi. Il y a encore cinq à dix ans, le travail des jeunes filles était principalement centré sur les tâches ménagères. Ça l’est encore. Dès qu’elles apprenaient à marcher et à parler, les filles étaient initiées aux travaux domestiques. Les garçons, eux, y étaient aussi formés dès leur plus jeune âge. Une fois qu’ils atteignaient la puberté, ils prenaient conscience de leur rôle distinct de celui de leurs sœurs et abandonnaient les tâches ménagères pour se concentrer sur le pâturage des chèvres et la collecte du fourrage pour le petit bétail. Il y a cinq à dix ans, ce travail était effectué par les jeunes garçons à partir de 15 h, lorsqu’ils prenaient les chèvres pour les mener paître dans les brousses environnantes de la ville et reviendront avec du fourage.
« Ces lapins et ces cobayes qu’ils élèvent ne servent pas seulement à la consommation. Ils sont parfois vendus, et les revenus permettent d’acheter des souliers, des vêtements, voire de payer la scolarité des enfants, avant la mise en place de la gratuité de l’enseignement », explique Mbusa Gérôme, un parent du quartier Mutiri.
Aujourd’hui, les 190,3 km² de la ville de Butembo sont de plus en plus saturés. Dans certains quartiers, il n’y a plus d’espaces vides disponibles. Et lorsque de tels espaces existent, ce sont souvent des champs familiaux. Aller y faire paître les chèvres ou récolter du fourrage est perçu comme un vice social. Tout parent qui vous surprend en train de le faire a le droit de vous réprimander. Comme presque tout le monde se connaît, la nouvelle parvient rapidement à vos parents, et vous risquez de recevoir une fessée de papa ou de maman le soir avant le souper sinon la privation du souper peut-être la punition qui remplace la fessée.
Ainsi, il devient de plus en plus difficile de faire paître les chèvres et de trouver du fourrage pour les cobayes et les lapins. Si un enfant est poussé à chercher du fourrage à tout prix, il risque de se retrouver à l’autre bout de la ville, exposé à tous les dangers.
C’est ainsi qu’est née une nouvelle activité commerciale: la vente de fourrage dans les ronds-points et les rues fréquentées des quartiers, principalement pendant les heures vespérales.
Un business à risque…
À partir de 16h, les femmes qui reviennent des champs périphériques de la ville apportent des tas de fourrage qu’elles vendent à ceux qui sortent du travail. Chaque tas coûte 500 Fc et est suffisant pour nourrir moins de 5 cobayes, juste pour une soirée.
Ainsi, plus on possède de cobayes ou de lapins, plus on doit acheter de fourrage. Ce commerce est devenu florissant. En grande majorité, ce sont les femmes et les enfants qui s’occupent de cette vente, qui dure jusqu’à 20h du soir. Parfois, même sous la pluie vespérale, les enfants restent dans la rue pour vendre ces fourrages. Ce commerce est fragile : si les fourrages ne se vendent pas dans la nuit, la seule option restante est de les donner à leur propre élevage.
Cependant, tous les vendeurs ne sont pas au premier niveau. Certains achètent en gros pour les revendre dans leurs quartiers. Cela signifie que s’ils n’écoulent pas toute leur marchandise, ils subissent des pertes.
« J’achète un sac à 4000 Fc, et après la vente, j’en tire environ 10 000 Fc », raconte Solange, une jeune fille d’une quinzaine d’années. Elle a commencé à vendre pour sa mère, mais s’est ensuite mise à son propre compte pour subvenir à ses besoins.
« C’est un risque que l’on prend, comme dans tous les métiers. Moi, en quittant mon champ, j’achète des sacs auprès des villageois et mon épouse m’attend ici, au rond-point, pour les vendre. Je ne sais pas ce que je ferais du reste si je n’avais pas de lapins chez moi. Ce ne seraient que des pertes. Car nous sommes devenus nombreux à vendre et les clients sont les mêmes qu’avant », se plaint Papa Jules, qui dépose trois sacs de fourrage à son épouse au rond-point Mihake.
En effet, ce business prend de l’ampleur. Certains utilisent même des engins roulants, tels que des camions Ben, pour acheter des fourrages dans les périphéries de la ville et les revendent ensuite aux détaillants du centre-ville. Ces détaillants se placent à leurs tours dans les carrefours des quartiers pour vendre leur marchandise.




… Pour un élevage de prestige
L’élevage du petit bétail est devenu une affaire culturelle. Le cobaye et le lapin représentent un plus dans l’alimentation des ménages.
Le cobaye grandit rapidement et se multiplie à un rythme impressionnant (quatre à cinq portées par an). Il tombe rarement malade, à condition qu’un minimum d’hygiène soit respecté dans son élevage. Sa viande est riche en protéines et pauvre en graisses. Il constitue une source de viande et de revenus facilement accessibles pour l’éleveur qui en possède un grand nombre. Il fournit également un engrais organique de qualité pour les champs.
Les besoins en capitaux pour démarrer l’élevage sont minimes et son alimentation est peu coûteuse, n’entrant pas en concurrence avec celle de l’homme (fourrage, déchets de cuisine, etc.). La gestion de cet élevage est simple et peut être assurée même par des enfants, y compris ceux issus de familles pauvres.
Les ménages désireux de reconstituer leur élevage peuvent commencer par l’élevage de cobayes, et leur vente peut faciliter l’accès à d’autres animaux, tels que des chèvres, des moutons, des porcs, voire des vaches, comme le souligne l’International Journal for Rural Development .
Une enquête a été menée auprès de 60 éleveurs répartis sur l’ensemble de la ville de Butembo. Les résultats montrent que les cobayes sont généralement élevés au sol dans la cuisine, dans un local spécifique ou dans des cages. Dans la majorité des cas, l’élevage des cobayes est de type familial. Ce type d’élevage, pratiqué de manière traditionnelle, se caractérise par des effectifs réduits d’animaux. L’alimentation repose presque exclusivement sur l’apport d’herbes et de résidus de cuisine.
En raison de l’absence de gestion par l’éleveur et du manque d’appui extérieur en matière de formation aux techniques modernes d’élevage, la productivité reste faible. Plusieurs facteurs contribuent à cette faible productivité, tels que la mortalité, la promiscuité, le manque d’aliments concentrés, les maladies, les prédateurs et l’absence d’organisation adéquate.
Pour améliorer la productivité de l’élevage des cobayes, il est crucial de renforcer les connaissances sur les systèmes d’élevage et de promouvoir les techniques d’élevage améliorées. De plus, les éleveurs de cobayes devraient bénéficier d’un accompagnement et d’un encadrement afin de les encourager à adopter des pratiques commerciales et à faire évoluer leur mode d’élevage.
Ces conditions ne posaient pas de problème lorsque le fourrage était gratuit. Aujourd’hui, avec l’obligation d’acheter le fourrage, beaucoup se rendent compte que l’élevage devient une activité déficitaire.
« J’avais plus de 15 cobayes. Je devais dépenser plus de 20 000 FC par jour pour l’achat des fourrages. Quand je calcule le coût total, je me dis qu’il serait préférable d’acheter un cobaye au marché à 5 000 FC, que de perdre mon argent dans cet élevage », témoigne M. Charles, un jeune commerçant habitant au quartier Centre Commercial.
Le professeur Siviholya Kito, enseignant en zootechnie à la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université Catholique du Graben à Butembo, souligne que « l’élevage du petit bétail domestique n’est rentable que si l’on cherche soi-même le fourrage. L’avantage d’acheter des fourrages sur le marché, c’est d’y recourir en cas de besoin, lorsque l’on ne peut pas aller au champ. »
En République Démocratique du Congo, comme dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne, la question de la sécurité alimentaire est particulièrement pressante, car 57 % de la population congolaise souffre d’un déficit en protéines, tant végétales qu’animales.
Tant en milieu rural qu’urbain, les conditions de vie des populations restent précaires. Cette précarité contribue à la sous-alimentation et à la malnutrition chronique, des phénomènes qui continuent de soulever des débats sur la mise en place de solutions durables. Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) préconisent la vulgarisation et la promotion de l’élevage de cobayes (caviaculture) comme l’une des solutions durables pour répondre à la demande en protéines dans les ménages
Dans cette étude intitulée « Caractérisation des systèmes d’élevage des cobayes (Cavia porcellus L.) en ville de Butembo, République Démocratique du Congo », publiée dans l’International Journal of Innovation and Applied Studies, le Professeur Siviholya Kito et ses collaborateurs concluent que la caviaculture à Butembo est pratiquée par toutes les couches de la société, sans distinction de genre, d’âge, d’état civil, de niveau d’instruction ou de profession.
Bien que l’élevage des cobayes présente des avantages nutritionnels, économiques et sociaux considérables, les pratiques actuelles dans les élevages traditionnels souffrent d’un manque de suivi et de technicité, car elles sont principalement menées par des enfants et des jeunes sans formation préalable. L’élevage de cobayes se caractérise par une faible productivité, due à de nombreuses contraintes telles que la mortalité des animaux, la recrudescence des maladies, la mauvaise gestion, l’alimentation non équilibrée, ainsi que l’absence de formation ou d’encadrement des éleveurs.
Ces difficultés pourraient être surmontées par un meilleur encadrement des éleveurs et la mise à leur disposition de géniteurs de qualité par les services étatiques compétents, ainsi que par l’amélioration de l’accès à des matériels adaptés.
Hervé Mukulu & Jackson Sivulyamwenge
Bois du Congo-Ouganda : un commerce alimenté par des irrégularités
Par Joël Tali et Gérald Tenywa Lorsque l’on cherche le meilleur bois dur en Ouganda,…
Qu’est-ce que le Couloir Vert Kivu-Kinshasa ?
Le Couloir Vert Kivu-Kinshasa est une aire protégée à vocation de réserve communautaire, créée par…
Comment le bois illégal du Congo alimente le marché du bois du Rwanda ?
Le marché du mobilier haut de gamme du Rwanda dépend fortement du bois importé de…
Conférence à l’UCG : des étudiants sensibilisés aux innovations en chimiothérapie
Des étudiants de l’Université Catholique du Graben (UCG) à Butembo ont été édifiés ce samedi…
La préférence du Soudan du Sud pour le bois étranger vaut-elle le prix payé en République Démocratique du Congo ?
En entrant sur le marché du bois à ciel ouvert de Juba sous un soleil…
« Virunga, 100 ans d’un Parc d’exception » : un ouvrage pour célébrer un siècle de conservation
À l’occasion de la Journée mondiale de la biodiversité et dans le cadre des commémorations…